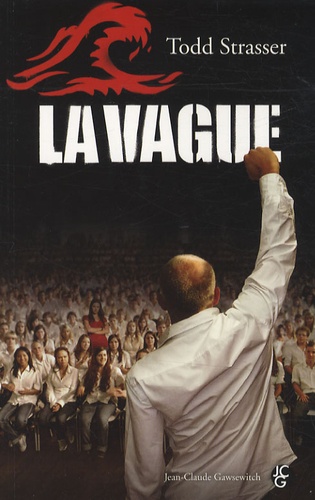Enfant illégitime d’une époque peu encline à offrir un destin de reine aux filles du peuple, Gabrielle Chanel avait le verbe fleuri et l’imagination en bandoulière à l’heure d’évoquer les pans douloureux des premières années de sa vie. Confiée à la mort de sa mère aux religieuses de la Congrégation du Saint-Cœur de Marie à Obazine (“Oba quoi ?”, avait-elle coutume de répondre aux importuns l’interrogeant sur cette période), elle n’eut de cesse de réécrire les lignes de son histoire, d’inventer de nouvelles versions, d’ajouter des épisodes édifiants, d’arranger les faits et d’enjoliver le portrait de groupe d’une famille de forains originaire de la région cévenole. Dans son livre L’allure de Chanel, Paul Morand se fait l’écho d’une enfance passée en Auvergne auprès de tantes (imaginaires), austères et goûtant peu sa présence jusqu’à son départ à l’âge adulte pour Moulins et son beuglant, La Rotonde : « J’avais cru avoir une enfance modeste, je m’aperçois qu’elle était somptueuse. En Auvergne, tout était vrai, tout était grand », lui aurait-elle révélé un jour pour brouiller davantage encore les cartes et achever de jeter le trouble dans l’esprit de son interlocuteur. D’autres biographes donnèrent moins volontiers créance au florilège d’anecdotes livrées par celle qui un jour déclarait avec malice en guise d’avertissement : « Voilà tout ce que je suis. Vous avez bien compris ? Eh bien, je suis aussi le contraire de tout cela. Voilà les matériaux que m’a fournis ma mémoire, avec les pièces qu’on a jetées dans mon jardin et avec les poutres que j’ai trouvées dans l’œil du voisin ». « La légende a la vie plus dure que le sujet ; la réalité est triste et on lui préfèrera toujours ce beau parasite qu’est l’imagination. Que ma légende fasse son chemin, je lui souhaite bonne et longue vie ! » Gabrielle Chanel semble, au fil des lectures, ne s’être accommodée de la présence des fantômes du passé qu’au prix de leur silencieuse docilité et de leur opportune utilité dans son art de la composition.

Née dans un milieu défavorisé, privée trop tôt du giron maternel, elle aura trouvé refuge dans le travail, seule manière pour elle de continuer à aller de l’avant et de ne pas sombrer sous les coups de boutoir du destin. « J’ai fait des robes. J’aurais pu faire bien autre chose. Ce fut un hasard. Je n’aimais pas les robes, mais le travail. Je lui ai tout sacrifié, même l’amour. Le travail a mangé ma vie ». Mue par une soif éperdue de reconnaissance sociale, puisant au plus profond d’elle-même la volonté de démoder ce qui lui déplaisait tout en existant dans le regard des autres, Gabrielle Chanel a construit une légende à nulle autre pareille sur fond de conflits mondiaux, de tempêtes historiques, de rencontres amoureuses et de clins d’œil à son passé, de mutations socioculturelles et de redéfinition du luxe, d’emprunts à l’univers vestimentaire masculin, de contre-pieds sublimes au “système de la mode” personnifié par Paul Poiret. « Une robe n’est ni une tragédie, ni un tableau ; c’est une charmante et éphémère création, non pas une œuvre d’art éternelle. La mode doit mourir et mourir vite, afin que le commerce puisse vivre ».

Les signes d’identification du “total look” Chanel (l’escarpin à bout noir, le sac matelassé avec sa chaîne dorée, la petite robe noire, la broche multicolore en forme de croix, la veste de tailleur, le catogan, le bouton doré frappé du double C, un camélia) signent autant de moments-clés de sa propre histoire que de partis pris esthétiques, de gestes de subversion pleinement assumés, de désir d’en finir avec « les habits de parade, les dentelles, les corsets, les dessous, les rembourrages ». La fleur de camélia ? Coco prêtait à sa mère les maux et la même fin tragique que Marguerite Gautier, l’héroïne de La Dame aux camélias, le roman d’Alexandre Dumas fils. La petite robe noire ? Une proche cousine de la robe en paillettes noires portée du temps où elle était gommeuse à l’Alcazar de Vichy. La pureté de ses lignes, le noir d’ordinaire réservé à bien d’autres usages sociaux et rituels, l’encolure ras du cou et le fourreau de crêpe à manches longues tombant sous le genou bouleversaient les codes vestimentaires, les règles de civilité, les disciplines gestuelles autant que les mentalités de son temps. Le tailleur noir et la cravate flottante en crêpe de Chine ? Un parent de la blouse en lustrine des collégiens de Moulins. Le cuir matelassé ? Un emprunt aux vestes de lad vues sur les champs de course. Les cheveux courts ? Le besoin de punir “Boy” Capel, l’homme de sa vie _« mon frère, mon père, toute ma famille »_ parti en épouser une autre. Le tweed, les chandails, le jersey, la marinière ? L’héritage des années de bonheur passées à ses côtés. Les blouses de moujik, les pelisses et les ornementations à base de broderies, de paillettes colorées portent quant à elles témoignage de sa courte idylle avec le grand duc Dimitri Pavlovitch, neveu du défunt tsar. Les breloques et les parures de fantaisie ? Une idée bien à elle, pour moquer la pompe d’une certaine aristocratie et le classicisme des bijoutiers de la Place Vendôme.

Prêt-à-porter Printemps-Eté 2009
La saillie verbale lui brûlant sans relâche le bord des lèvres, elle cultivait volontiers son personnage auprès de ses contemporains, clientes, couturières et employés de maison. C’est bien elle pourtant qui offrît à ses dernières avant l’heure des congés au soleil, qui mît dans le plus grand secret le pied à l’étrier de ses chevaliers servants, peintres et poètes aujourd’hui couronnés, elle qui entretînt une cour de gens de lettres, de dramaturges, de cinéastes, de prince russe sans le sou, tout en affirmant : « Mon entêtement, mon incompréhension, mon désir de ne pas écouter, mes œillères ont été les vraies causes de mon succès » ; « Moi je suis de la classe des femmes bêtes, des femmes qui ne pensent qu’à leur travail, et, le travail fini, qu’aux tireuses de cartes, aux histoires des autres, aux événements du jour, aux stupidités ». Excellente couturière, même si elle s’en défendait sans doute par coquetterie, mais dessinant mal, elle astreignait ses mannequins à de fastidieuses et harassantes séances d’essayage, voletant des heures dans un ballet étourdissant, une paire de ciseaux à la main et un sébile d’épingles dans l’autre, autour de leurs silhouettes fourbues, fourmillant sans cesse d’idées nouvelles, faisant disparaître toute fioriture, ajustant le tissu jusqu’à ce qu’il épousât parfaitement les courbes du corps. Mademoiselle avait mauvais caractère et la sentence définitive. Inflexible, autoritaire, généreuse, entière, opiniâtre et passionnée, elle n’aimait rien tant que l’élégance, le dépouillement, humer l’air du temps pour en saisir les tendances à naître, détourner les vêtements de leurs fonctions originelles. Mademoiselle avait du génie et le bon sens de ne pas s’en laisser conter à l’heure des bilans, des attaques en règle sur ses fréquentations douteuses et ses engagements politiques.

« J’ai créé la mode pendant un quart de siècle. Pourquoi ? Parce que j’ai su exprimer mon temps. J’ai inventé le costume de sport pour moi ; non parce que les autres femmes faisaient du sport, mais parce que j’en faisais. Je ne suis pas sortie parce que j’avais besoin de faire la mode, j’ai fait la mode justement parce que je sortais, parce que j’ai, la première, vécu la vie du siècle » (Morand). Si Coco Chanel a su libérer le corps des carcans où il était confiné en redessinant les contours de la silhouette féminine, elle le doit bien sûr à l’emprunt raisonné de certains signifiants vestimentaires typiquement masculins (motifs et uniformes des mondes du travail et du sport) mais aussi, plus fondamentalement, au désir d’affirmer une identité visuelle se voulant dès l’origine indémodable. Acharnée selon Edmonde Charles-Roux « à ne vouloir jamais reconnaître d’autre mérite ni imposer d’autre nom que le sien » (rappelons par exemple que Madeleine Vionnet proposait des robes noires dès les années 10), elle réfutait cependant que la haute-couture pût être un art. « La mode est dans l’air, disait-elle, c’est le vent qui l’apporte. La mode se promène dans la rue sans savoir qu’elle existe, jusqu’à ce que je l’aie exprimée à ma façon ». L’aplomb et le culot de Coco fascinent toujours, tant sa légende intime a épousé les soubresauts de l’histoire, illustré l’album photo du siècle, éduqué les regards, ouvert les esprits et redéfini les notions de confort et de praticité du vêtement. Gabrielle, la petite main sortie de nulle part, la commise de la rue de l’Horloge à Moulins dans une maison spécialisée en trousseaux et layettes en route vers la consécration, la chanteuse au mince filet de voix se jouant sans ciller, crânement, de tous les obstacles, « la plus cossarde des femmes » (Balsan) devenue un bourreau de travail, infatigable et sourcilleuse, continue d’émouvoir et d’intriguer. « Ses colères, ses méchancetés, ses bijoux fabuleux, ses créations, ses lubies, ses outrances, ses gentillesses comme son humour et ses générosités, composent un personnage unique, attachant, attirant, repoussant, excessif…humain enfin » (Cocteau).

Nouvelle boutique Chanel Joaillerie, conçue par l’architecte Peter Marino
Des plages de Deauville à l’hôtel Ritz, des bras du duc de Westminster à ceux du chargé de mission du ministère de la Propagande du Reich, Hans Gunther von Dincklage, de ses débuts dans la confection de chapeaux boulevard Malesherbes aux paravents de Coromandel ornant aujourd’hui la nouvelle boutique Chanel Joaillerie sise 18, Place Vendôme, s’offre en partage le portrait tout en contrastes et en complexité d’une femme dont le legs n’a pas fini de consacrer la beauté des formes du corps féminin. Depuis sa mort, les référents visuels “habillent” les campagnes publicitaires comme autant de balises culturelles rappelant l’extraordinaire richesse du patrimoine conçu au 31 de la rue Cambon. Aujourd’hui, la femme Chanel, mélange de force de caractère, de volonté, de prestance et de maintien, est la digne petite-fille d’une Coco veillant de près, par sa seule présence spirituelle et parfois son apparition fugitive dans un visuel, au respect de l’identité narrative de la marque. Loin des effets de manches de ses coreligionnaires ou des inspirations vestimentaires douteuses de nos contemporains. « Les modes, assénait-elle, sont bonnes quand elles descendent dans la rue mais pas quand elles en viennent »…
Sources : E.Charles-Roux, L’irrégulière ou mon itinéraire Chanel, Grasset ; P.Morand, L’allure de Chanel, Folio ; E.Weissman, Coco Chanel, Maren Sell Editeurs ; J.-M.Floch, Identités visuelles, PUF ; B.Remaury, Marques et récits, Editions du Regard.