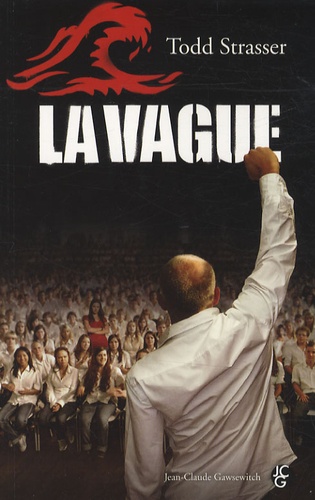
Une tempête dans un verre d’eau
Relatant une expérience menée en 1969 par Ron Jones, un professeur d’histoire contemporaine au lycée Cubberley de Palo Alto (Californie), La Vague jouit depuis sa première parution en 1981 aux Etats-Unis d’un succès d’estime pour le moins étonnant si l’on en juge par les nombreuses zones d’ombre du récit, les suspicions entourant la véracité de certains faits rapportés, le manque de fiabilité des rares informations factuelles données dans le texte (le nombre de victimes dans les camps d’extermination et de concentration est erroné. On ne peut que déplorer à ce propos que l’éditeur n’ait pas jugé bon de le mentionner en note de bas de page), les témoignages labiles et contradictoires des principaux témoins et, plus grave de notre point de vue, la faiblesse insigne du texte.
Disons-le sans détour, le roman ne présente aucun intérêt sur le plan littéraire : platitude du style, saynètes inconsistantes mettant en scène des adolescents sans épaisseur, situations insuffisamment fouillées et travaillées pour emporter l’adhésion de tout lecteur désireux de comprendre les mécanismes psychologiques ayant conduit des élèves de première à adhérer aussi facilement à un projet pédagogique calqué sur le modèle d’endoctrinement des Jeunesses hitlériennes. Rapidement dépassé par l’ampleur du mouvement et les actes répréhensibles commis en son nom, le prosélytisme de ses partisans, la dérive sectaire et l’obtuse stupidité d’étudiants transformés en suiveurs fanatisés et décérébrés, Ron Jones n’aura d’autre choix que de se soumettre à la raison après avoir quelques jours caressé des rêves de grandeur et de contrôle des esprits, au mépris de ses propres convictions.


En ne parvenant pas à convoquer les fantômes du Troisième Reich au chevet des passions et de la folie ordinaire de ses personnages, le livre de Todd Strasser échoue à lever un coin du voile sur un phénomène éminemment complexe et délicat à appréhender, nécessitant une connaissance approfondie des processus pouvant amener un individu à se faire le meilleur avocat d’une propagande le privant de ses libertés.
« Tout était planifié en détail, nous devions juste faire comme il nous disait et il n’y aurait aucun problème ».
« Tout était si soudain, si libérateur, irréel et instantané, comme dans un de ces rêves flottants qu’on peut faire au cours d’un bref assoupissement en pleine journée ».
« On est prêt, tout à fait prêt, on ne pense à rien d’autre, à l’intérieur de soi on est si vide, si nettoyé. On a atteint ce point en prévision duquel on s’est laissé ressourcer, prisonnier de sa bêtise et de sa confusion, de son appréhension et de sa teneur. On ne pense qu’à cette seule et unique chose. Un ordre, et ce qu’on fera ensuite sans hésitation. Tout ça fonctionne si parfaitement ».

Ces citations sont extraites du roman de Jens-Martin Eriksen, Anatomie du bourreau (Editions Métailié, 2001), décrivant de manière clinique la lente déconstruction psychique et l’effrayante docilité d’un milicien enrôlé de force, magistral contrepoint à l’étude référence de Christopher Browning, Des hommes ordinaires (Ed. Belles Lettres, 1994) sur les exactions des Einsatzgruppen en Pologne entre juillet 42 et novembre 43. Joignant la rigueur au talent d’écriture, destinés à des lecteurs exigeants se détournant des artifices narratifs comme des portraits de groupe simplistes, ces deux livres, incontournables pour comprendre les racines de l’obéissance à l’autorité, les stratégies de dissimulation et de mensonge à soi-même employés par des individus placés dans des situations extrêmes, devraient figurer en bonne place, au milieu des classiques sur le sujet, dans les bibliothèques idéales.

« Quand on ne prend pas l’histoire au sérieux, on ne se soucie pas de la différence entre jeu et réalité » disait Ruth Klüger dans Refus de témoigner (Viviane Hamy, 1997). Ron Jones aurait dû s’en souvenir. Todd Strasser aussi, en s’emparant de son histoire. Après lecture, La Vague s’est retirée en laissant derrière elle un goût amer et un doute tenace. Serait-il donc si facile de séduire un million et demi de lecteurs rien qu’en Europe ?
NDLR : La Vague a été adaptée sur les écrans par Dennis Gansel (actuellement au cinéma). Son action se déroule dans un collège en Allemagne de nos jours.
Todd Strasser, La Vague, Jean-Claude Gawsewitch Editeur (rééd. Pocket).
Parution L'Hebdoscope du 25/03.








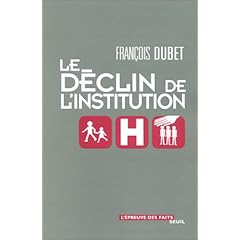
![[worst.JPG]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDo-Mu3X0E3oOVSkaoffGb6fKlfj00T_F0qxq1M4ueERK3AsGNCQH7PcaKqk4JkPGMyspOKzhocPh_qb2yzqUmXo0Hexg503TvH1TwR1tgCh1WNP5Xw-DP9hPx8XT2-d_YpocllwMqzew/s1600/worst.JPG)
![[sad.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE-nJkopsm1QKoiQOvD32WMOUv6XgZPDuC4ygQVXtAXELAszSEXqbb6FLdK5lAHjQWyxEHaRBr6K8mbuYqDYKT2C429b-XaaTgQ29bqKn0WXuSYU5uUxttPHNANpp7ZcWlyJCVtGa4-1w/s1600/sad.jpg)
![[dark.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCfD_RWREimRej43nlWOLMv8javhjQHlTqYg8sGQXsxozT3TKv3dZ9EfQqcmB3feU1QCUNKyhdE25_Mz6-05c5xCjjlM1LH-r3cLgAjlnqV6NGal73YCIZoeqlyxbqJDhtzd0CIPBmHNE/s1600/dark.jpg)
![[dark.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEyW6vi37oWPlcCKz4MX716PT3GUgprem9GQ5X-10kw4CgpUu22RpHfzaN5uZR9hQyPTFh8L-AG1kAPFbtpczdxJOJVhebO1LGywhBcqlTK-5BNXfPocrYBiiJJOCI6xwZqfgqi6U6G-Q/s1600/dark.jpg)
![[reproduction.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv5osMb2UB2G-166EqSUuvTwdOmLBPu5t2xoKAgtYG_snCZ6iBL5O2z2dmuDAMzdS_Ons51EermmUwLfPZMqjd3V46p_DJfgeaqAYS6DG8Yi9bsM6MzMZfop1BjKUJGLoAknQxg4d__7E/s1600/reproduction.jpg)





